|
LA PRISE D'ALGER
EN JUILLET 1830 : QUAND UNE CREANCE PRIVEE DEVIENT UNE AFFAIRE D'ETAT |
|
Tout débuta en 1796 quand le
Directoire emprunta un million de francs sans intérêts
à Hassan Pacha, dey turc d'Alger (1791- 1798), somme destinée
à l'achat de blé dans la Régence. Avant la révolution, les achats
par la France y étaient faits par la Compagnie royale. Après
1794, aux grands services de l'Etat succéda l'Agence nationale,
laquelle eut recours à deux négociants israélites,
Michel Cohen Ben Zahout dit Bacri, et Neftali Bou Djenah dit Busnach.
La manière dont, de fil en aiguille, ces derniers réussirent
à devenir les intermédiaires exclusifs entre la France
et la Régence d'Alger, mérite d'être exposée.
Etant dans la faveur du bey turc de Constantine, Busnach fut chargé
par ce dernier de lui procurer une parure qu'il voulait offrir à
la favorite du dey d'Alger, son supérieur hiérarchique.
Busnach s'acquitta de cette demande et il présenta au bey un
diadème acheté 30.000 francs à Paris et qu'il
lui revendit 300.000 francs… Or, l'achat fut payé à
Busnach sous la forme de 75.000 mesures de blé d'une valeur
de quatre francs la pièce, soit 300.000 francs qu'il revendit
à 40 francs l'unité à la France… Désormais introduit à
Paris, le tandem Bacri-Busnach obtint ensuite l'exclusivité
des fournitures en blé à la République au départ
de la Régence d'Alger. Afin de multiplier leurs gains, et
cela à plusieurs occasions, les deux compères s'entendirent
avec les corsaires d'Alger qui interceptèrent les convois,
ce qui leur permit de revendre plusieurs fois la marchandise à
la France. Un stratagème qui fut énoncé par le consul de France
à Alger, Jean Bon Saint-André, ce qui, en 1797, conduisit
le Directoire à suspendre les versements aux deux aigrefins.
Bacri et Busnach comprirent alors que, s'ils voulaient rentrer dans
leurs fonds, il allait leur falloir être appuyés par un personnage
influent… et ce fut alors qu'ils lièrent leur sort à
Talleyrand[1]. En effet, Bacri et Busnach achetaient
les cargaisons de blé au dey d'Alger Mustapha (1798-1805) pour
les revendre à la France. Or, et nous venons de le voir, comme
le Directoire avait cessé de les payer, les deux intermédiaires,
n'étaient donc plus en mesure de rembourser le dey d'Alger.
Simon Aboucaya, commis de la maison
Bacri fut alors envoyé à Paris avec le titre officiel
d'« Agent général chargé des affaires du
dey d'Alger ». Finalement, en 1800, probablement à
la suite d'une intervention de Talleyrand, Bacri et Busnach qui avaient
présenté une facture de 7.942 .992 francs, reçurent
un acompte de 3.175.632 francs qu'ils ne déclarèrent
pas au dey d'Alger. Ne voyant rien venir, le 12 août
1802, ce dernier écrivit un nouvelle fois à Paris en
demandant que la facture présentée par Bacri et Busnach
soit acquittée car il s'agissait bien de son argent. Les deux compères présentèrent
alors aux autorités françaises une nouvelle ardoise
augmentée des intérêts qui s'élevait à
8.151.000 francs. Un second acompte de 1.200.000 francs leur fut versé
qui ne fut pas davantage déclaré au dey. Perdant patience, ce dernier exigea
alors le versement immédiat de 7 millions de francs afin d'en
finir une fois pour toutes avec cette affaire qui Tout resta cependant en l'état
jusqu'en 1819, c'est-à-dire sous la Restauration, quand la
France décida de solder cette affaire. Les commissaires royaux aux comptes
menèrentalors une enquête approfondie aux termes de la-
quelle la créance de la France que le tandem Bacri-Busnach
estimait désormais avec les intérêts à
24 millions de francs, fut ramenée à 7 millions, somme
payable en douze versements de 583.333,33 francs. Cependant, nombre
d'armateurs, notamment marseillais, n'ayant jamais été
payés par la paire Bacri-Busnach, et le dey devant quant à
lui de fortes sommes à des privés français, 2.500.000
francs furent mis en réserve à la Caisse des Dépôts. La lutte contre la piraterie encore
trop souvent avancée par des auteurs dont le « logiciel
» est resté bloqué sur une littérature
obsolète n'était pas le motif de l'expédition,
même si ce fut un artificiel motif avancé pour la justifier. En effet, alors que cette activité
dévastatrice avait fait la fortune de la Régence turque
d'Alger jusqu'au début du XIXe siècle, en 1830, elle
avait cessé. Lors de la prise d'Alger au mois de
juillet 1830, furent certes libérés 122 captifs, mais
il ne s'agissait pas d'esclaves européens, mais de 80 membres
des équipages de deux navires français, l'Aventure et
la Silène qui avaient fait naufrage, ainsi que d'une vingtaine
de soldats débarqués à Sidi-Ferruch et qui avaient
été faits prisonniers.
Etonné de voir encore figurer
le consul parmi les représentants des nations étrangères
accréditées à Alger, le dey le congédia.
Se voulant méprisant, il lui notifia qu'il devait se retirer
de sa vue au moyen du chasse-mouches qu'il tenait à la main.
Il n'y eut pas de soufflet donné à Deval, mais la France
exigea néanmoins des excuses. Au mois de juin 1827, le consul de
Sardaigne fut ainsi chargé par Paris de remettre un ultimatum
aux autorités d'Alger. Selon ses termes, le Dey avait 24 heures
pour présenter des excuses, arborer le pavillon français
sur tous les bâtiments officiels et faire saluer ce dernier
par cent un coups de canon. Les principaux officiers de la Régence,
à l'exception du Dey lui-même, devraient se rendre à
bord du vaisseau La Provence mouillé en rade d'Alger pour y
présenter des excuses au consul Deval. Le dey Hussein ayant rejeté
cet ultimatum insultant, la marine française mit alors le blocus
devant Alger. Le 4 octobre 1827, l'escadre algéroise
tenta de forcer le blocus, mais elle fut écrasée par
les navires de l'amiral Collet. Le 4 janvier 1828 le gouvernement
Villèle fut renversé et Martignac qui lui succéda
ordonna la poursuite du blocus. Hésitant à lancer une
expédition contre Alger, le gouvernement français pensa
alors à une intervention indirecte faite par le pacha d'Egypte
Mehemet Ali qui serait encouragé à s'emparer de Tripoli,
de Tunis et d'Alger. Mehémet Ali accepta contre 28 000 000
de francs et 4 navires de ligne. La France ne proposant que 10 000
000 de francs et seulement le prêt de 4 vaisseaux, Méhémet
Ali refusa. Dans ce marchandage destiné à lui éviter
de devoir lancer l'expédition d'Alger, la France offrit finalement
20 000 000 de francs payables en deux fois, plus 8 000 000 à
la place des 4 navires dont le ministère de la Marine refusait
de se séparer. L'accord ayant été conclu,
Paris informa les puissances européennes, mais Londres intervint
auprès de la Prusse et de la Russie afin de bloquer l'accord
franco-égyptien. Devant l'hostilité de ces Etats, Méhémet
Ali rompit alors les discussions. Désormais, la marche à
la guerre n'allait plus pouvoir être arrêtée. D'autant
plus que le 17 juin 1829, les frégates Duchesse de Berry et
L'Iphigénie tentèrent de détruire un navire corsaire
mouillé près de Dellys. La mission fut réussie,
mais trois chaloupes s'échouèrent et les quatre-vingt
marins qui les montaient se retrouvèrent encerclés.
Après une résistance désespérée,
une cinquantaine réussit à regagner les autres embarcations,
mais vingt-deux matelots et deux officiers furent massacrés
et leurs têtes salées vendues à Alger. Le 3 août 1829, prenant conscience
de la réalité de la situation, la France fit un dernier
et double geste d'ouverture en levant le blocus d'Alger et en envoyant
des parlementaires. Or, les Turcs prirent cette démarche pour
de la faiblesse et ils bombardèrent le navire des plénipotentiaires.
Dès lors, l'expédition fut décidée et
lancée à partir du plan de débarquement qui avait
été dressé en 1808 par Vincent-Yves Boutin [1] Le 12 décembre 1803, Jacob Bacri
écrivit à son cousin Abraham Bacri que « Si le Boiteux (Talleyrand)
n'était pas dans ma main, je ne compterais pour rien ». Bernard LUGAN
L'AFRIQUE REELLE - n°176 - AOUT 2024 PAGE 15 |
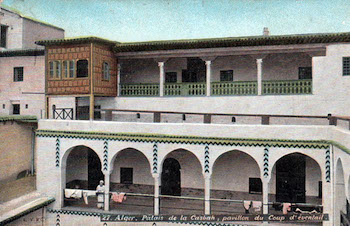 La
prise d'Alger en juillet 1830 a pour origine immédiate la filouterie
de deux aigrefins qui dupèrentà la fois la France et
la Régence turque avec la complicité de Talleyrand.
Une entreprise « affairiste » qui cristallisa avant de
les hystériser, les tensions entre Paris et Alger, et qui débouchera
sur le débarquement du mois de juillet 1830.
La
prise d'Alger en juillet 1830 a pour origine immédiate la filouterie
de deux aigrefins qui dupèrentà la fois la France et
la Régence turque avec la complicité de Talleyrand.
Une entreprise « affairiste » qui cristallisa avant de
les hystériser, les tensions entre Paris et Alger, et qui débouchera
sur le débarquement du mois de juillet 1830. Aussi,
persuadèrent-ils alors ce dernier que sa seule chance de récupérer
sa créance auprès d'eux était qu'il fasse directement
valoir aux autorités françaises que les sommes qui leur
étaient dues au titre des achats de blé devaient en
réalité lui revenir… Voilà comment des créances
privées devinrent une affaire d'Etat.
Aussi,
persuadèrent-ils alors ce dernier que sa seule chance de récupérer
sa créance auprès d'eux était qu'il fasse directement
valoir aux autorités françaises que les sommes qui leur
étaient dues au titre des achats de blé devaient en
réalité lui revenir… Voilà comment des créances
privées devinrent une affaire d'Etat. Le
dey Hussein (1818-1830) qui avait hérité des créances
Bacri-Busnach, ne comprit pas pourquoi cette somme avait été
consignée et pourquoi elle ne lui était pas immédiatement
versée. Il s'impatienta donc et il fit porter son courroux
sur le consul de France Pierre Deval dont il demanda le rappel à
Charles X. Or, la réponse française n'était pas
arrivée à Alger quand, le 30 avril 1827, se produisit
l'« incident Deval ».
Le
dey Hussein (1818-1830) qui avait hérité des créances
Bacri-Busnach, ne comprit pas pourquoi cette somme avait été
consignée et pourquoi elle ne lui était pas immédiatement
versée. Il s'impatienta donc et il fit porter son courroux
sur le consul de France Pierre Deval dont il demanda le rappel à
Charles X. Or, la réponse française n'était pas
arrivée à Alger quand, le 30 avril 1827, se produisit
l'« incident Deval ».